Comment les enseignants évaluent-ils les raisons de l’échec ou de la réussite de leurs élèves ? Une grande enquête leur donne la parole, et le rôle de la famille y apparaît comme essentiel. Décryptage, pour mesurer les enjeux de l’implication des parents et d’une bonne communication, dès le début de la scolarité.
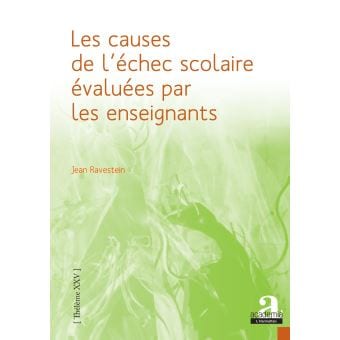
Éditions Academia – Collection Thélème
Août 2019 – 208 pages – ISBN 978-2-8061-0451-9 – www.editions-academia.be
Professeur des universités émérite en sciences de l’éducation à Aix-Marseille Université (AMU), Jean Ravestein a été instituteur, puis psychologue scolaire avant de devenir universitaire en 2000. Il est également directeur de publication de la revue indexée Questions vives – Recherches en éducation et formation.
Une des grandes variables dont l’ensemble de la littérature scientifique s’accorde à dire qu’elle joue un rôle très important dans la réussite ou l’échec de l’élève : c’est la famille. Nous avons affaire ici à une variable très composite, ce qui rend difficile l’approche de son impact de manière générale.
En effet, il y a les conditions de vie objectives de l’enfant organisées par la famille : sommeil, alimentation, loisirs sportifs ou culturels, régulation de l’accès aux médias, espace dévolu à l’étude, langue principale parlée et sa qualité, etc. Et les rapports que la famille entretient avec l’école : régulation des devoirs, questionnement intéressé sur ce qui s’apprend, participation aux activités de l’établissement, aux réunions parents-professeurs, relais des sanctions ou des compliments importés de l’école, etc.
Ainsi, les extrêmes qui cumulent points négatifs ou positifs ne posent guère de questions : un enfant de famille monoparentale démunie, dormant peu, mal nourri, collé devant les écrans plus que de raison, que l’on ne questionne jamais sur ce qu’il apprend et doit savoir, qui parle une langue différente et entend un français approximatif et dont le responsable n’a jamais mis les pieds dans son école a moins de chances de réussir, et inversement.
Toutefois, des travaux, notamment ceux du sociologue de l’éducation Bernard Lahire (1998, 2017), montrent par exemple qu’un niveau de ressources faible du point de vue matériel, linguistique ou culturel n’est pas forcément synonyme d’échec pour l’enfant si un certain nombre d’autres composantes de la variable sont présentes, comme une écoute attentive ou un questionnement intéressé par lesquels les parents montrent que, pour eux, ce qui est fait à l’école a du sens et de la valeur.
Ces parents vont donc tout faire pour faciliter à leur mesure la scolarité de leur enfant, par exemple en aménageant un lieu calme pour l’étude que la fratrie devra respecter, et le valoriser dès qu’il pourra aider par son niveau scolaire les frères et sœurs et les parents eux-mêmes.
Ce faisant, ils créent une fonction familiale importante occupée par l’enfant qui y gagne en reconnaissance, en légitimité. Bernard Lahire (id.) affirmera que ces démarches de légitimation familiale jouent un rôle central dans la possibilité d’une bonne scolarité.
Pour beaucoup de familles populaires et défavorisées, la scolarité de l’enfant est rejetée à la périphérie de leurs préoccupations et c’est une attitude indifférente qui prévaut, ce qui plonge l’enfant dans une certaine solitude.
Dans le pire des cas, la scolarité de leurs enfants est vécue comme un rapport de domination dont ils se sentent victimes, qui leur rappelle de mauvais souvenirs, et ils développent alors une résistance passive (parfois active) à l’égard de cette institution dont ils ont été largement exclus, comme pour d’autres institutions dominantes dans la société (travail salarié, consommation, etc.).
Ceci renvoie aux études sur « le sentiment de compétence parentale » (Tazouti & Jarlegan 2010) et son influence sur la trajectoire scolaire de l’enfant. Il a été analysé sur trois dimensions : l’exercice de l’autorité parentale et la communication avec l’enfant, l’aide scolaire proprement dite apportée et le contact avec l’institution, mais aussi la participation à la vie scolaire.
Plus le niveau social des familles est élevé, plus les parents manifestent un sentiment de compétence élevé. On constate des liens positifs entre le sentiment de compétence parentale, le suivi parental de la scolarité de l’enfant et la participation parentale effective à la vie scolaire.
Il faut indiquer que si le suivi influence les performances de l’enfant, celles-ci influencent à leur tour la manière dont les parents vont s’investir dans le travail de l’enfant. On trouve donc dans certaines familles populaires, en particulier lorsque les enfants sont jeunes et en difficulté, un sentiment de compétence parentale fort sur deux dimensions « suivi et participation », ce qui crée un cercle vertueux.
Toutefois, dès que le niveau scolaire dépasse grandement le propre niveau des parents, l’aide scolaire proprement dite devient difficile et là se creusent encore des inégalités entre les capitaux scolaires, difficilement comblés par des cours particuliers, vu que les finances ne suivent pas. Beaucoup de familles populaires font « tout ce qu’elles peuvent », mais à un certain niveau, elles sont dépassées et s’en remettent à l’institution.
Ce que les parents doivent faire pour éviter l’échec :
Paroles d’enseignants
« Avoir une confiance sans faille dans les professeurs », « faire exécuter aux enfants très exactement ce qu’ils demandent, en particulier pour les devoirs », « ne pas interférer avec leurs décisions (méthode, redoublement, orientation) »
« Livrer » des enfants polis, déférents, dociles, en bonne santé, bref : « bien élevés » et foin des « enfants rois ».
Sur les plans cognitif et affectif, la plupart des recherches concluent à une pluralité de mécanismes de transmission, une variabilité des formes de tutelle parentale et une diversité des façons d’agir et de réagir du côté de l’enfant, si bien qu’il est difficile d’établir des patterns précis de familles aidantes ou moins aidantes.
Toutefois, on peut dégager des grands principes mis en avant par les recherches qui favorisent la réussite et qui recoupent le bon sens. Geneviève Bergonnier-Dupuy résume (2005 : 7) : « En fait, les pratiques familiales favorables au développement cognitif et à la réussite scolaire de l’enfant sont basées sur une éducation caractérisée par le contrôle souple, la sécurisation (avec la mise en place de routines familiales permettant d’anticiper et de prévoir), le soutien affectif des parents ainsi que leur prise en compte de l’enfant en tant que personne (possibilité de donner son avis, consultation de l’enfant à propos des décisions le concernant, valorisation de l’autonomie de l’enfant). »
On peut recenser nombre d’études qui s’intéressent à des points plus précis liés à l’apprentissage, en particulier pour les très jeunes enfants : langage, lecture, résolution de problèmes ; au-delà de l’apprentissage des codes de bonne conduite en famille qui peuvent se prolonger par une adaptation réussie au contrat didactique qui contraint les apprentissages à l’école.
Évidemment, si l’enfant acquiert tôt un vocabulaire riche et adapté, rencontre la pratique de la lecture à la maison « pour le plaisir » et se voit placé devant des problèmes qu’on lui laisse résoudre et dont on exploite les erreurs et tâtonnements, il est mieux « armé » pour la réussite.
Toutefois, il convient de nuancer : si le « système didactique auxiliaire » (Johsua & Félix 2002) que peut constituer la famille entre en dissonance avec celui – principal – de l’école, des problèmes peuvent surgir. Si l’enfant revient de vacances de chez son grand-père lettré avec la compétence de calculer une multiplication per gelosia, pas sûr qu’il n’y ait pas un petit conflit avec le maître, s’il lui explique (ce qui est la vérité) qu’elle est plus simple à mettre en oeuvre : les erreurs sont faciles à détecter ; pas de gestion des retenues de multiplication, seulement d’addition ; on peut s’arrêter et reprendre quand on veut ; on n’a pas de décalage de ligne à gérer et pas de difficulté pour les zéros intercalés.
Pas plus que l’on a facilité la compréhension de la numération en choisissant de dire quatre-vingt-dix au lieu du très logique nonante, il n’est pas question de protester, notre grand-père fût-il belge ou suisse ! Si une telle dissonance peut simplement gêner provisoirement le rapport au savoir de l’élève en mathématiques (qui a raison, finalement ?), on entrevoit que celui-ci peut se trouver plus compliqué à gérer encore en histoire ou en philosophie, dès que l’élève grandit et raisonne, selon ce qu’il importe comme convictions de la maison à l’école jusqu’à rendre l’enseignement impossible (comment enseigner Darwin à un élève issu d’une famille d’obédience créationniste ?).
On voit donc ici encore que c’est une communauté de sens et de valeurs entre la famille et l’école qui peut favoriser la réussite ; ou générer l’échec si cette communauté n’est pas – ou mal – établie. D’ailleurs, dans un registre plus large, on voit se multiplier des écoles privées (outre les écoles religieuses très orthodoxes, déjà existantes), qui recrutent des élèves issus de familles attentives à ce qu’il n’y ait pas de conflits de valeurs, de contenus, mais aussi de méthodes pédagogiques avec l’école de leurs enfants. Aura-t-on bientôt des établissements aux cantines véganes avec relaxation-méditation trois fois par jour ? On peut s’y attendre.
Comment agir face à des élèves happés par leurs écrans, peu attentifs en classe ? Les pistes d’A. Baumier-Klarsfeld pour « Réveiller le désir d’apprendre ».




